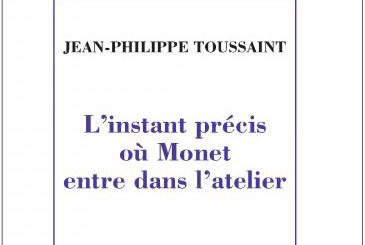Hors champ, « Mariées trop jeunes », l’expo de Stéphanie Sinclair

Too Young to Wed, de Stephanie Sinclair, Arche du photojournalisme, Grande Arche de la Défense.
Quand on pénètre dans l’immense espace d’exposition, triste et rustique béton cubique sous néons, on est saisi par les couleurs des images, la naturelle palette saturée des couleurs de l’Afrique, de l’Orient et de l’Asie, par la beauté des visages féminins, la jeunesse, les ventres rebondis de la fécondité. L’intimité acquise par une photographe pour se fondre dans des fêtes, des cérémonies, des processions, de simples travaux des champs ou domestiques saute aux yeux et invite à prendre son temps pour traverser 12 ans de photographies de Stephanie Sinclair.

Too Young To Wed de Stephanie Sinclair. Yemen.
Dans ce voyage à travers tous les continents, au milieu de nombreuses ethnies, de multiples religions, on pourrait se trouver dans la traditionnelle position du voyageur qui prépare son voyage en feuilletant Géo. Les paysages sont superbes. Les gens sont beaux et paisibles. Le cadrage, l’éclairage, les plaines et les places inondées de lumière, les clairs-obscurs des intérieurs, tout nous conforte dans le spectaculaire et la beauté que nous aimons consommer en vitesse, superficiellement, avec extase, dans nos voyages. 175 magnifiques clichés qui auraient leur place dans les catalogues des tours opérateurs. Sur le toit de l’Arche, cette exposition aurait pu être le concentré de dépaysement que nous recherchons pour nos vacances.
Mais voilà. L’intitulé de l’exposition, « Too Young to Wed, mariés trop jeunes« , et le premier panneau introductif : « 15 millions de jeunes filles sont mariées de force chaque année, partout dans le monde« , changent l’esprit du visiteur. Ce n’est plus la beauté de chaque image, la fraîcheur de chaque visage que l’on remarque, mais des regards plus tristes, des larmes au milieu d’une fête, la détresse. Les explications s’accumulent sur la notice de chaque image ; le contexte, hors champ, vient troubler le décorum touristique : 5 ans, 11 ans, enlevé, viol par les ainés, fistule, excision, brulée vive, suicide. Aucune région du monde n’est épargnée, USA, Europe de l’est … J’étais à la fois séduit par l’image, ému par ces petits visages, tout en sentant mon estomac peser de plus en plus lourd. C’est étrange comme la conscience pèse sur l’estomac.
Cette exposition me rappelait les difficiles découvertes (parmi de magnifiques autres ; mais toujours complexes) d’un trek puis d’un séjour, réalisés à deux ans d’intervalle, au Sahel, dans un des pays de l’Afrique saharienne.
Magnifique trekking, notre premier contact avec le désert, enthousiasmé par la beauté des quelques femmes et des enfants que nous rencontrions dans des oasis désertées en hiver. Nous dégustions l’apparente écologie, le calme et la sérénité du désert. Ce n’est qu’au retour, en lisant les statistiques de mortalité (hommes, 45 ans – femmes 48 ans) que j’ai réalisé que nous n’avions rencontré que les survivants, les plus solides. Les vieux et les malades étaient morts.

Pendant la Guetna. Mauritanie, Août 2003. Chantal Delacroix.
Séjour de deux ans, travaillant dans une entreprise, noyé parmi les autochtones. Si les oasis que nous avions vu en hiver n’étaient habitées que par quelques familles noires, si les huttes étaient abandonnées, ce que j’avais perçu, sans la comprendre, comme une ambiance d’éxode, c’est parce-que seuls quelques Haratines (nom donné aux anciens esclaves qui restent dans un esclavage de fait, lié définitivement à l’oasis et dans la famille dans laquelle ils grandissent, souvent sans salaire) y séjournent toute l’année. Nous y sommes retournés pendant l’été, au moment de la cueillette des dates, quand toute la tribu maure revient, quittant les villes, que l’oasis est alors emplie de cousins et cousines, que les huttes, les tikits, sont décorés, que les tentes sont montées, que près des sources et des canaux d’irrigation, à l’ombre, toutes les générations font la sieste, boivent le thé et prient avant de festoyer la nuit. C’est en effet à ce moment que l’on décide, négocie et consomme les mariages.
À l’issu d’une de nos randonnées, nous sommes rentrés en avion. Nous partagions la rangée de siège avec l’un des directeurs de l’entreprise, diplômé de Harvard, un sexagénaire que je croisais habituellement tous les soirs rentrant à pied, dans sa tenue bleue, de l’usine vers son logement.
« Que faisiez-vous ? — Je rentre de l’Oasis. — En vacances ? — Non. Je me suis marié. — Votre femme n’est pas avec vous ? — Non, elle reste en ville. — Ah ? — Oui, dans quelques jours, c’est la rentrée du collège. — Vous avez encore des enfants scolarisés ? — Non. Il s’agit d’elle. Elle a 13 ans. — … — Je comprends que vous ne puissiez comprendre. — … — Ici, pour cette cousine pauvre, c’est une chance. Avec moi, elle pourra faire des études. »
Je suis resté muet pendant tout le reste du voyage, ne sachant que dire, n’osant pas m’offusquer.
Aujourd’hui, après cette exposition, cet épisode me revient en mémoire et mon silence d’alors me gène. Mais qu’aurait-il changé, puisque cet homme, ce VIP, diplômé d’une des universités américaines les plus réputées, comprenait et assumait la raison de mon silence.