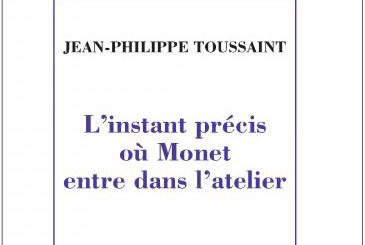Corot, la Glane et les clichés-verre.

Chaos de la Glane. SIte Corot. Saint-Junien
Au bord de la Glane, les deux fillettes avaient dépensé leur trop plein d’énergie en pataugeant dans l’eau, curiosité satisfaite en dénichant galets et coquillages, avant de rentrer, de grimper sur les bras ou le dossier du fauteuil éculé, sages instants pour entourer leur arrière grand-père, deux têtes blondes sous la reproduction d’un Corot, Souvenirs de Mortefontaine.

Souvenir de Mortefontaine. B. Corot. Musée du Louvre
Corot avait saisi l’instant. Figé ombres, éclats et silhouettes dans son imaginaire. Il avait choisi la toile, l’huile, toutes les palettes de verts et de bleus pour transcrire l’innocence des jeux d’enfants noyés en contre-jour.
Nous étions deux, par une chaude journée d’été en Limousin, où nous avions choisi le chaos de la Glane, à Saint-Junien, pour laisser les enfants s’ébrouer au frais, sous notre surveillance bienveillante et attentive, photographiant ces scènes juvéniles et bucoliques. Comme souvent, Chantal avait choisi la couleur et son approche picturale de l’image. Moi, celle, plus graphique, du noir et blanc.
Corot n’avait-il qu’un choix ? S’encombrait-il systématiquement vers 1855, quand il s’enticha des bords de Glane, de tout le matériel du peintre ? Devait-il, image en tête, remonter dans le chalet qu’il avait bâti en hauteur, hors de porté des crues, pour figer tout cela sur la toile dans le long travail des pinceaux et des brosses, le savant mélange des pigments ? Dans ses compositions, que restait-il de l’émotion initiale ?
Aujourd’hui, comme tous, nous vivons dans l’instantané. En l’adaptant, héritiers du 20ème siècle mais acteurs du 21ème.
Même appareil photographique. Lumineux et spacieux viseur télémétrique, objectif standard afin que les deux yeux grand ouverts laissent le cadrage s’intégrer instinctivement dans l’ensemble, bague de diaphragme sous les doigts transcrivant la prépondérance du sujet dans la profondeur du paysage. Mais dans nos têtes, l’alchimie est différente. Comme autrefois (il n’y a guère que 20 ans !) quand on partait en promenade, on avait fait le choix du négatif, couleur ou noir et blanc. Ce parti pris, on percevait alors différemment les scènes, économisant les clics dans ce que l’on savait, à priori, pictural ou graphique. Et, dans ce choix, rarement inapproprié — la lumière est finalement trop plate aujourd’hui pour le noir et blanc — on trouvait un plaisir, une variété d’intention que nous n’avons pas voulu sacrifier. Deux boitiers identiques, mais, comme deux pellicules, deux capteurs. Un boitier couleur, un boitier noir et blanc que nous échangeons parfois.

B.Corot – Cliché-verre
Les peintres, les impressionnistes qui comme Camille Corot avaient fait le pari de la lumière, de son mouvement, pour traduire nos émotion étaient-ils contraints par leur choix ? Pouvaient-ils penser en noir au-delà de quelques croquis à la mine de plomb ou d’ébauches au fusain ?
Vers 1855 donc, au bord de la Glane, Corot enduisait parfois d’encre et de poudre de céruse une plaque de verre. Rapidement, d’une fine pointe, il traçait ses impressions du jour, tirant ensuite forêts, bords de rivière, étangs et jeux d’enfants sur quelques clichés-verre[1].
Pour les reprendre à l’occasion, sur la toile et réinventer les couleurs.
Comme nous le faisons nous-même, le soir, en retrouvant le plaisir d’une journée.
Couleurs picturales pour Chantal. Graphisme du noir pour moi.

Bord de Glane – Saint-Junien
[1] Héliotypes