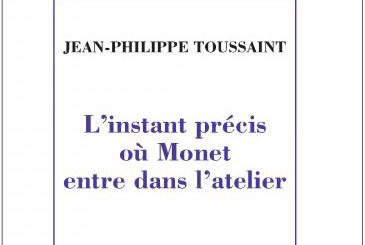Désert de Retz. Samedi 22 octobre 2011
Extrait de “Le Désert de Retz” (dans En Pays connu, 1950) de Colette.
Point n’est besoin de guide pour monter jusqu’à la métairie qu’effondrent ses parures de roses et de vigne. De là le regard visite, comme un beau corps se lit sous une fourrure épaisse, le dessin naturel du Désert, l’heureux vallon dont se servit un homme de cour qui par chance fut un homme de goût. Montueux, varié, ouvert en son centre à la lumière et à la course des eaux, percé d’allées qu’on devine, là blanchi de houx panachés, rougi de hêtres pourpres, le domaine est seulement épaissi de végétation déchaînée. Le reste est harmonie, car la Colonne Détruite n’est qu’une fantaisie sans portée. Son seuil franchi, l’escalier central tourne ingénieusement, les salons rouent autour de sa cage, distribués en pièces ovales, en boudoirs qui s’agencent sans mièvrerie…
Ce n’est pas sans effort d’esprit que nous tâchons à déchiffrer, dans les appartements de la Colonne, son premier destin de demeure élégante, accueillante et diverse, qui marie aux rectangles la mollesse de sa courbe extérieure. Actuellement on respire, entre ses murs cintrés, autant de plaisir que de légitime appréhension. Un rôdeur armé n’oserait pas, de nuit, séjourner ici. Pas plus que nous il n’aimerait le chaos mobilier, ni la présence d’un rideau sombre qui ne tient au mur que par deux plis funéraires. Comme nous il préférerait, à cet injustifiable et expressif rideau, n’importe quelle paisible chauve-souris éployée. Un malfaiteur ordinaire consent à trouver, derrière les battants d’un placard, quelque squelette, mais non point une chaise haut pendue, penchée sur le vide, et qui a cessé d’appeler au secours. Qu’est-ce qu’une couleuvre effrayée, au prix des yeux blancs d’un vieux serpent qui nous regarde, mort, bercé dans son bocal ? Comment se convaincre que dans cette ombre de geôle un dossier de lit en palissandre, un fauteuil décharné et les débris d’une machine à coudre ne sont pas maléfiques ?
Ovales, ménagées dans les profondes cannelures de la Colonne, les fenêtres ont éclaté. Rien ne résiste à la plante croissante. Devant une vitre en morceaux, je songe qu’un moment vint où la vitre céda, avec fracas, sous la muette insurrection de la glycine. Les mêmes sarments ont d’abord étouffé, il y a plus d’un siècle, les aloès frileux, les acacias de Farnèse et ces “grenadilliers” qui n’étaient pas des grenadiers, mais bien la passiflore grimpante, en espagnol granadilla… Maintenant le lierre, la treille sauvage et sa fleur cotonneuse qui sent le réséda barrent, à toutes les fenêtres, l’aimable vue. Deux rejets de vigne, animés de l’hostilité végétale qui semble viser l’homme, tendent des crochets si significatifs que je m’écarte : ils m’ont peut-être vue…
L’orage peu à peu alourdi se colle à l’étang. C’est pourtant vers l’eau que nous descendons, à cause du murmure, à cause du frisson, à cause de ce qu’une source porte en elle d’intelligible et de rassurant. Car la bouche ébréchée de la glacière sous son tumulus pyramidal, son entonnoir et son silence ne nous valent rien ; aussi bien la journée décline. Un crépitement d’oiseaux annonce le soir. Avec lui vient le vœu de laisser dormir, de laisser périr ce passé que la saison seule gorge de vie. Encore un peu de temps, et le Désert de Retz ne sera plus qu’un poème à l’image d’une époque. Mais n’est-ce pas déjà beau que d’une époque on sauve un poème ?…