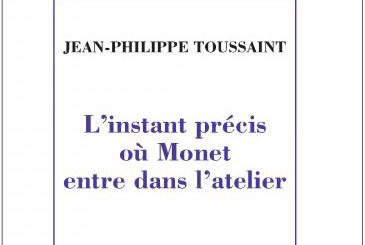De « J’traînais des pieds dans mon café » à « La commode aux tiroirs de couleurs »
J'traînais des pieds dans mon café Les vieux à la belote braillaient Papi, mamie, tonton André et toutes ces pépées À mes p'tits soins, à m'pouponner Toute la famille tête dans l'guidon Du temps où on pouvait faire les cons Les pensionnaires, les habitués, les gens d'passage surtout l'été Joyeux bordel dans mon café Écorché mon visage, écorchés mes genoux Écorché mon p'tit cœur tout mou Bousillées, mes godasses, bousillées sur ma joue Bousillées, les miettes de nous
C’est cette chanson 1, entraînante, torturée autant que joyeuse, nostalgique et optimiste, entendue un matin sur France Inter, qui m’a fait découvrir Olivia Ruiz.
Quelle ne fut pas ma surprise d’apprendre qu’elle avait participé à la Star-Academy (sans la gagner), ce qui fit tomber mes préjugés télé phobiques.
Avec curiosité et plaisir je l’ai vue en concert et l’ai régulièrement écouté, à chaque nouveau disque, sur Qobuz. Mais plus que tout je suis impressionné par le talent qu’Olivia Ruiz déploie aussi au cinéma, au théâtre, en décoration, avec boulimie, me demandant pourquoi autant de dons peuvent être offerts par la nature à une seule personne.

Quelle ne fut pas encore ma surprise de l’entendre présenter dans la Matinale de France Inter son premier roman. Une déclaration d’amour à ses grands-mères et grands-tantes traduite non pas dans une biographie — réfugiées espagnoles, elles n’avaient rien conté de leur histoire, déni que je connais fort bien pour l’avoir constaté moi aussi dans ce milieu qui a baigné mon enfance —, mais dans une fiction, présumant d’une histoire familiale qu’elle a fantasmée, puisant dans les faits divers de l’exode républicain espagnol autant que dans l’ambiance du café-restaurant de ses aïeules situé à Marseillette dans l’Aude, dans ce pays d’immigration espagnole.
Olivia Ruiz peut-elle être aussi douée en écriture romanesque que dans ses autres pratiques ? Un pressentiment me dit que oui, et nous achetons donc ce court roman publié par JC Lattes.
Après m’être un peu ennuyé sur ce « Avant que j’oublie » 2 d’Anne Pauly (Prix Inter 2020), autofiction certes intéressante par le goût sucré salé de tendre affection et humour acide — roman que j’ai d’ailleurs déjà globalement oublié au-delà de l’évocation de la disparition d’un père inavouable —, j’ai plongé avec empathie dans le récit épique, engagé, politique, drôle, admiratif de la vie de la grand-mère et de tous les protagonistes de « La commode aux tiroirs de couleurs » 3 . Si juste est l’évocation des réfugiés et des autochtones, du désir d’intégration et des réflexes de xénophobie, de cohésion sociale et familiale, mais aussi du désir d’autonomie et de revanche.
Ce court roman est un pertinent et non conformiste hommage à la féministe féminité de ses femmes espagnoles.
Le récit rebondit d’évènements en évènements dont Olivia Ruiz profite pour embarquer le lecteur que je suis, le dérouter souvent, l’étonner parfois. Elle crédibilise cette fiction si personnelle en laissant s’évader des tiroirs colorés de la commode l’ambiance et les personnages déjà suggérés dans les chansons de « Femme chocolat ».
Et ce jusqu’à l’originale, drolatique, impertinente, provocatrice et émouvante, si humaine apparition de Lola dans le dernier chapitre — je vous laisse découvrir cela…
Bravo Olivia Ruiz. Vous m’avez une fois de plus surpris. Comment posséder tant de talents ?
Petite jalousie…