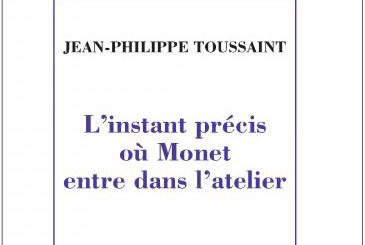Madame reçoit
Nouvelle écrite pendant l’été 2019.

Catherine Le Floch… décédée à 92 ans… sans héritière… le seul contact c’est vous… des obsèques civiles… jeudi 7 novembre… cimetière de Roubaix… onze heures, du message enregistré sur le répondeur je n’ai retenu que cela.
Je me suis affalée dans le sofa, sous la verrière de mon atelier qui plongeait déjà dans la pénombre du soir, face au mur qu’illuminaient quelques-unes de mes œuvres les plus récentes, résolument abstraites, trouvant dans la plus tourmentée l’écho de la surprise, de l’étourdissement, d’une vague tristesse, de la rancœur aussi, de la confusion des sentiments que provoquait cette nouvelle.
Catherine ! Ce ne pouvait être qu’elle. Celle perdue de vue depuis — combien déjà ; je compte sur mes doigts — vingt-deux ans. Catherine qui veillait sur la maison et qui n’avait jamais voulu, par convenance plus que par froideur, que je l’appelle Cathy.
Le visage rose de jeune fille sage qu’elle gardait malgré ses rides, le chignon soigneusement tiré aussi lisse que sa moralité, le joli col en dentelle involontairement coquin qu’elle portait sur un austère chemisier noir, le tablier blanc orgueilleusement bordé de la même dentelle immaculée qui égayait à peine la jupe noire, aussi raide que ce qu’elle voulait paraître, l’allure de douairière que lui imposait sa condition de gouvernante, bien supérieure à celle de cuisinière et de bonne, les trente ans de bons et loyaux services auprès de Madame qu’elle revendiquait comme un sceptre ou un passe-droit, tout cela a resurgi. Catherine qui ne laissait sourdre que rarement, quand j’acceptais qu’elle entrât dans ma chambre loin des regards qui auraient dissipé son autorité, un peu de tendresse de mon enfance.
Je m’étendis sur le sofa, fermai les yeux. Lens et Loos, leurs rues de briques rouges qui menaient aux mines qu’enfant j’avais aperçues lors de rares sorties. À l’orée d’un parc, les imposantes demeures des ingénieurs dont la façade principale gardait l’entrée du puits, avant-garde du carré des maisons des chefs qui régentaient la fosse autant que les corons adjacents. Et entre tous ces quartiers, notre maison, « La Villa du bonheur », accueillante et discrète à la fois, où tout ce qui comptait (et dépensait sans compter) se retrouvait le soir, le samedi et parfois le dimanche après la messe.
Cloîtrée au deuxième étage, j’entendais les domestiques accourir dès que Maman tirait la sonnette. Les craquements du plancher sous le pas lourd de Charles, le majordome, quand Maman sonnait trois fois ou, bien plus fréquemment, après juste deux sonneries, comme un survol, Catherine qui s’activait à pas feutrés. Puis le couinement de la porte qu’ils ouvraient, qui laisser échapper bâillements et soupirs.
Mon univers : réduit aux soupirs, aux frôlements, aux pas qui s’empressent, les grincements d’une porte qui résiste et de la serrure que personne ne pense à huiler.
J’ouvrais alors la porte de ma chambre qui donnait sur le couloir et, au-delà des reflets de l’encaustique, argentés comme le ciel ou dorés par le soleil du matin, ou sombres, tirant sur le rouge bordeaux des rideaux de velours que l’on fermait le soir et qu’éclairait le lustre de cristal coloré en forme de tulipe, la porte de maman à nouveau fermée.
Sur la tablette du radiateur je dévisageais la geisha de porcelaine dont le naïf sourire semblait me narguer, rayonnante le matin à la lumière du jour, mais je trouvais menaçante, veillant sur la porte close, insensible à mes états d’âme, le soir.
Les fluctuations de la lumière qui régnait dans le couloir semblaient accordées aux bâillements du matin ou aux toux sèches du soir, à l’odeur du café que masquaient vite les cigarettes et celles, celles plus ténues des liqueurs du soir.
J’attendais dans le silence : ne pas bouger ; ne pas me faire voir ; garder la porte juste entrouverte ; attendre, le cœur battant.
Bien Madame…
Oui Madame, elle dort encore…
Oui Madame, sa porte est fermée…
Non Madame, elle n’est pas descendue…
Bien Madame. Je lui dirai qu’elle ne peut pas encore vous voir… Oui, qu’elle patiente… demain vous serez certainement moins fatiguée, plus disponible…
À tout à l’heure Madame. Sonnez quand vous voulez.
J’attendais que la porte de Maman grince à nouveau pour vite refermer la mienne et me protéger des regards indiscrets.
Puis le feulement des pas de Catherine qui m’oubliait aussitôt. Elle retrouvait Charles en haut de l’escalier. Je percevais leurs conciliabules sans les comprendre. Maman les entendait-elle ? Je saisissais juste les intonations : l’indifférence souvent, la compassion parfois, l’exaspération rarement, la déférence toujours.
Quand les chuchotements s’étaient tus, je rouvrais la porte, curieuse et malheureuse à la fois, déchiffrant les odeurs et les quelques soupirs et les rires qui s’échappaient de la chambre de Maman malgré toutes les précautions. Café, tabac, alcool, les odeurs de ma frustration. Maman ne m’appelait jamais.
Je me jetais alors sur mon lit, me carapatait sous le moelleux de l’édredon à la recherche d’un peu de douceur, de chaleur, faute de tendresse. Je ne voulais plus quitter la chambre, comme Maman. Je honnissais ce mot qui me séparait d’elle et que ressassait Catherine : fatiguée ! Fatiguée !
Tout à l’heure, tubes fermés, brosses nettoyées, mains et ongles récurées des taches d’acrylique, j’aurais pu ne pas écouter le message. Avec Catherine je n’avais aucune attache autre que cette animale fidélité que construisent des années de cohabitation. Pourquoi suis-je revenu à Lens ? Peut-être à cause de la complicité implicite des prisonnières, car nous étions deux captives, moi d’une maison du bonheur où les enfants n’étaient pas attendus, elle d’une condition sociale qui garrottait l’affection.
Je fus effectivement seule à l’enterrement — Charles, le majordome, avait dû la précéder de quelques années — guidée par le maître de cérémonie et entourée des quatre employés des pompes funèbres et de leur indifférence, exécutant avec professionnalisme et courtoisie le service funéraire sans qu’aucun d’eux n’exprime un soupçon de compassion vis-à-vis de l’unique parente que j’étais supposée être.
Lens a bien changé depuis que je l’avais… fui. Les corons ont presque tous disparu après la fermeture définitive des puits. Proche de la gare, un étonnant bâtiment en forme de locomotive, le centre-ville s’articule autour d’une large avenue bordée de rutilantes maisons art déco, vestiges de l’apogée des charbonnages. Est-ce le hasard, l’intuition ou la réminiscence des souvenirs d’enfance qui me dirigèrent vers Loos-en-Gohelle, vers les deux terrils que je voyais dans l’enfilade d’une rue qui me semblait familière, quand je lus son nom sur une céramique usée sertie au plus haut d’une façade, juste sous le pignon : « La villa du bonheur » est encore debout, préservée.
Pourquoi ai-je décidé de rester dormir ce soir-là dans ce qui semble être désormais une pittoresque « Chambre d’hôtes » ? Est-ce, à la cinquantaine, ce besoin d’enfance qu’on éprouve parfois, incontrôlable ?
En novembre, un jeudi à Lens, toutes les chambres sont libres. « Je monte tout de suite mettre le chauffage » me rassura l’hôtesse, qui ressemblait un peu à la Catherine d’il y a vingt ans, à peine accueillante et tout aussi réservée ; et peut-être sur la défensive car je lui avais avoué, comme introduction, avoir grandi ici, à « La villa du bonheur », juste après-guerre.
Plutôt grande, chemisier blanc, pantalon bleue marine, chaussures à petit talon, même chignon, la molle rigueur d’une catéchiste, elle me fit quand même visiter le gigantesque hall que desservent un porche orné de vitraux colorés — cygnes arrogants et nymphéas romantiques, sous l’éclat d’un prétentieux arc-en-ciel —, une presque invisible porte détournée et, au fond, deux escaliers en colimaçon plutôt larges — qu’il fallait, je le sais aujourd’hui, pouvoir emprunter discrètement à deux, messieurs serrant mesdemoiselles par la taille, ou mesdemoiselles courant et devançant messieurs dans des éclats de gorge —, son fumoir sur l’arrière — où les mâles allaient commenter leurs conquêtes, s’enquérir des nouvelles recrues autant que des affaires —, son premier étage que parcouraient, face à chaque escalier, deux couloirs — on pouvait monter par l’un et redescendre discrètement ou diplomatiquement par l’autre, voire s’évader (s’éviter un scandale) par une autre porte dérobée —, ses six chambres, chacune signalée par une statuette, gitane à l’éventail, maure voilée, noire callipyge, ronde poupée russe — j’ai oublié les autres figurines qui m’amusaient et n’étaient là que pour rappeler à tous les messieurs la rare diversité des jeunes filles recrutées par Maman ; « mes filles » disait-elle —, où je retrouvai tous les meubles, les décors, les lustres, des plus élégants ou plus kitch, sauf les paravents et bidets de ces dames qu’elle avait remplacés par d’impersonnelles salles d’eau privatives, comme si elle avait voulu me plonger brusquement dans la solitude de ma jeunesse, moi « sa fille » bien plus recluse que « ses filles » et Catherine ?
Devais-je vraiment séjourner à nouveau, au bout du couloir, donnant à gauche sur celle de Maman, dans la chambre d’enfant meublée comme je l’avais laissée… aux jouets près ? Donnant à droite sur la chambre de « mon cher ami », ou des « Cher Jean… cher Paul ou Pierre » lorsque Maman avait consenti que ce « mon-cher-ami-là » mérite de rester plus longtemps que ceux dont elle se lassait vite.
Même tapisserie rose (c’était déjà le rose et les fleurs qui décoraient les chambres des jeunes filles). Même lourds rideaux que Catherine fermait rigoureusement tous les soirs et que j’entrouvrais aussitôt pour échapper à mes terreurs nocturnes d’un regard vers les lumières rassurantes de la rue.
Je remontai les draps, me noyai dans mon oreiller, assaillie soudain par le brouhaha de la musique du salon, des rires aigres, du bruit des verres, des pas dans l’escalier ; pas légers, espiègles de « ses filles », pas plus lourds des « Messieurs » qui trébuchent à quelque marche jusqu’à ce qu’une porte claque et étouffe enfin les rires et les gloussements d’impatience composée.
Je n’arrive pas à m’endormir. Me submergent la peur des pernicieux visiteurs qu’il me fallait éviter, la crainte des pas dans l’escalier, la phobie des portes qui grincent, des rires hauts et des rires gras.
Ce soir, les parquets du couloir et de la chambre sont recouverts d’un tapis lie-de-vin à motif d’iris bleus qui voudraient faire époque, qui étouffe les pas des éventuels autres locataires, me vole les reflets du parquet, la lumière du temps qui passe de ces soirs où j’espérais que le lendemain serait le jour où Catherine m’annoncerait souriante que Maman n’est plus fatiguée.
Le lendemain, vendredi, des averses prévues jusqu’au TGV du soir m’invitent à m’abriter dans des expositions. Après avoir remonté l’étonnante Galerie du Temps du Louvre-Lens où je retrouvais tous les maîtres de ma formation picturale, je décidai de passer par Roubaix et de découvrir « La Piscine », ces bains Art déco transformés en musée. Comme toujours, je préfère errer au hasard des salles où je survole les œuvres, laisse l’émotion me guider, et quand je suis comme aimanté, m’approcher, apprécier et me nourrir.
Juste après l’étonnante et immanquable piscine peuplée de statues, une galerie est réservée aux peintres et sculpteurs roubaisiens. Tiens donc ! Trop de peintures académiques et de scènes de genre à mon goût. Alors que je me presse, jetant juste un regard, pour entrer rapidement dans les galeries d’arts moderne ou contemporain qui doivent logiquement suivre, surgit face à moi un portrait : Monsieur Rémy ! « Mon-cher-Rémy » ! Un prétentieux autoportrait dans une posture académique, des lunettes rondes qui exagèrent un regard perçant, observateur et interrogateur ; trop sévère, il n’a plus rien du prévenant Monsieur Rémy fringué de sa blouse grise tachée de peinture qui venait faire, m’avait dit Catherine, les portraits des filles, et après avoir salué Maman m’avait apprivoisée de quelques dessins, puis de crayons, de fusains ; d’un premier compliment suivi de conseils ; et avait enfin rompu ma solitude. Quelques années plus tard Monsieur Rémy m’avait ouvert la porte — avec la bénédiction mesurée, âprement arrachée à Maman, me dit-il — de l’École académique de peinture de Roubaix. Puis enfin, le chemin de la liberté : les Beaux-Arts de Paris.
Émue, amusée, je le salue — je lui aurais presque parlé — et me retourne.
Face à lui, à moi, dans un cadre lourdement doré : le couloir, la porte de Maman fermée ; Georges penché en avant, genoux semi-fléchis pour mieux ajuster, l’œil rivé à la serrure, la joue et le cou rougeauds ; Catherine, impatiente, poussant de la hanche Charles qui jubile, réclamant son tour, l’œil salace, se retenant de rire dans une retenue complice si différente de celle de la compatissante Catherine qui passait me voir ; en bas, à gauche, presque hors cadre, un haut-de-forme, des gants de cuir beige et une canne à pommeau abandonnés insidieusement sur un tabouret.
Effarée, je passe convulsivement du fou rire de Catherine à Charles lorgnant par la serrure, puis au vaudevillesque chapeau.
Je m’évade de la scène en lisant l’étiquette : « Rémy Cogghe ; huile sur toile ; Madame reçoit ».
Madame reçoit ! Madame reçoit !
Je transpire soudain. J’essaye d’échapper à ces spectres, ces traîtres : une Catherine ricaneuse et perverse mise en scène par un « Monsieur Rémy » prétentieux et complice, dévoilant aux yeux de tous l’inconvenance d’une mère qui les « recevait » tous… que je croyais fatiguée, si fatiguée que j’avais fini par lui pardonner de m’avoir délaissée.