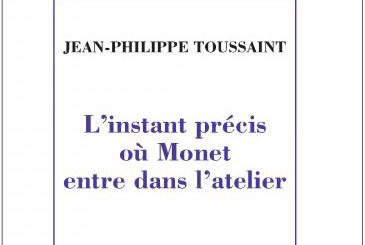« Né d’aucune femme » de Franck Bouysse ; « les mots » de Rose.
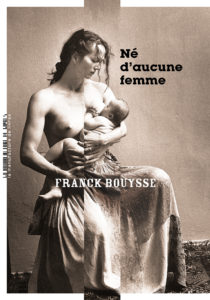
« Des livres et vous ». C’est le nom du club des lecteurs de la bibliothèque de Brech. Chaque mois, un auteur suggéré. Cela nous permet de découvrir Franck Bouysse. L’occasion de lire ce « prix des libraires 2019 » que j’ai vu maintes fois exposé dans les présentoirs des coups de cœur de différentes librairies et bibliothèque.
Un roman noir, très noir. Peu d’éclaircies. Je suis de l’avis de « Marianne » : « Un sculpteur hors pair de la langue et un maître sans égal de l’émotion« . Je n’ai pas pu en effet lâcher le livre, abandonner Rose, la narratrice des carnets, à son triste sort, bien que chaque élément de l’intrigue qui fait la noirceur de ce récit, m’ait semblé trop prévisible ; comme j’attendais que la page suivante confirme mon intuition.
Mais je ne résiste pas à vous faire écouter l’un des splendides passages du livre. Quelques pages sur les mots, un thème que je vénère.
C’est l’occasion de témoigner de cette « sculpture de la langue et maîtrise de l’émotion » que salue Marianne : voici ces mots… par Rose.
Extrait de « Né d’aucune femme », page 266 dans l’édition de « La manufacture du livre », ©2018
"C’est toujours ce qui se passe avec les mots nouveaux, il faut les apprivoiser avant de s’en servir, faut les faire grandir, comme on sème une graine, il faut bien s’en occuper encore après, pas les abandonner au bord d’un chemin en se disant qu’ils se débrouilleront tout seuls, si on veut récolter ce qu’ils ont en germe. Je sens bien que j’ai fini de vider mon sac de mots, qu’il m’en manquait pour bien vraiment dire les choses comme je les ressentais au moment où je les ressentais, que des fois ce que j’utilise colle pas exactement, que j’aurais besoin d’en connaître d’autres, plus savants, des mots avec plus de choses dedans. Les mots, j’ai appris à les aimer tous, les simples et les compliqués que je lisais dans le journal du maître, ceux que je comprends pas toujours et que j’aime quand même, juste parce qu’ils sonnent bien. La musique qui on sort souvent est capable de m’emmener ailleurs, de me faire voyager en faisant taire ce qu’ils ont dans le ventre, pour faire place à quelque chose de supérieur qui est du rêve. Je les appelle les mots magiciens : utopie, radieux, jovial, maladrerie, miscellanées, mitre, méridien, Pyracanthas, mausolée, billevesées, iota, ire, parangon, godelureau, mauresque, jurisprudence, confiteor, et tellement d’autres que j’ai retenus sans effort, pourtant sans connaître leur sens. Ils semblent plus légers à porter que ce qu’ils disent. Ils sont de la nourriture pour ce qui s’envolera de mon corps quand je serai morte, ma musique à moi. C’est peut-être ce qu’on appelle une âme. Ces mots, je voudrais les emmener jusqu’au bout, gravés dans les feuilles de mon cahier, bien mieux que des initiales sur un rocher. J’ai la mémoire de ces mots qui fabrique un monde rien qu’à moi, et qui d’habitude suffisent à me transporter loin d’ici, loin de mes souvenirs aux Landes, loin de mon petit perdu. D’habitude. Aujourd’hui il y a rien à faire, c’est mots me servent à rien, ils sont vides, pas capables de contenir ce que je voudrais y mettre. En vrai, les mots sont rien. Ils ont aucun pouvoir, plus aucun. Je me souviens de mon père en train d’attraper un cahier dans le bahut, ce qu’il faisait une fois par semaine, toujours le samedi soir. C’était un petit cahier avec le mot comptes écrit dessus en gros. Il savait pas bien écrire, mais ça, il savait l’écrire, et puis compter, aussi. Il buvait pas bien non plus d’habitude, mais ce soir-là, il portait la bouteille de gnôle pour faire mieux passer les comptes, le rapport entre le gagné et le dépensé, qu’il m’avait expliqué un jour. C’était jamais glorieux, à voir sa tête quand il arrivait aux chiffres du bas. Plus la bouteille se vidait vite, moins la semaine avait été bonne, la seule variation. Il y avait pas de meilleur baromètre pour dire le temps au Landes. En y réfléchissant, j’ai jamais vu la bouteille faire long feu. Je le regardais en coin, avec ses yeux qui disparaissaient petit à petit, jamais complètement, comme si la gnôle remontait exactement à cet endroit et pas plus haut. C’était pas un violent, mon père. Même quand il avait trop bu, il l’était pas. Aujourd’hui, je regrette qu’il y ait pas eu plus de violence en lui. Peut-être qu’alors il aurait pu davantage résister au maître, et qu’il serait encore vivant. Mais à quoi bon penser à ce qu’on peut pas changer. Fichue maladie. À quoi bon faire des comptes sur un cahier, si c’est pour faire des soustractions toute sa vie."