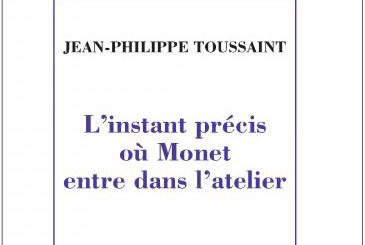Tryptique
De la pudeur…
Nous sommes modèles de mère en fille depuis trois générations. Ma grand-mère fut un des modèles d’Élisabeth Hahn, c’est dire.
C’est une tradition qui se transmet de manière… un peu incestueuse, un inceste par procuration.
On accompagne sa mère alors que l’on est encore fillette — Notez qu’il y avait peu de haltes-garderies à l’époque de ma grand-mère et que l’on n’était pas encore devenu aussi pudibond que de nos jours.
Voir sa mère se déshabiller, s’offrir au regard de l’autre, devient alors complètement naturel. C’est plus tard, en grandissant, que la notion de pudeur et d’impudeur vous habite.
La pudeur est un étrange sentiment. Je ne ressentais aucune appréhension quand je pénétrais dans l’atelier du peintre ou la salle du conservatoire. La présence des chevalets, des accessoires et des draperies, la lumière qui tombe de la verrière ou se diffuse de la baie qui donne sur le jardin, agissent comme une carapace. Aucune pudeur ne venait troubler l’instant où l’on tombe chemise et culotte et où on les range précautionneusement sur la pile des autres vêtements.
De même que je ne me jugeais aucunement impudique quand j’exécutais les instructions du peintre ou parfois du maître, sous le regard des élèves.
- De profil — Tournez-vous un peu vers moi — un peu plus ; encore ; voilà — remontez les genoux ; accoudez-vous sur eux, la tête entre les mains ; le dos moins rond — Voilà ; un peu plus haut que l’on voit la naissance des seins — Écartez légèrement les jambes que l’on devine la toison.
Studieuse, abandonnée, lointaine, je m’exécute. J’attends l’approbation finale complètement plongée dans une scène que j’imagine se composer.
Je ne vois que la tête et les épaules du peintre au-dessus de la toile, son regard pointilleux qui oublie la fille que je suis et ne perçoit plus que l’équilibre de mes formes, la douceur de mes courbes, la patine ou le perlé de ma peau que les ombres subliment. Galbe des mollets et des cuisses, rebondi du ventre, apesanteur des seins, hardiesse du cou, ironie de la bouche, éclair du regard.
Ce que je préfère c’est le moment où je sais, parce qu’il a pris le fusain de l’esquisse, que j’ai atteint ce juste équilibre entre pudeur et impudeur, cette expression séductrice, non impudente, que saisirait un photographe mais que je vais tenir tout le temps de la pose. Cet instant que le peintre et parfois ses élèves vont devoir garder en mémoire pendant les longues heures d’achèvement, peaufinant le grain, les moirés, toutes les nuances de mon corps au fusain, à l’aquarelle, à l’huile ou au pastel. J’imagine déjà mon attitude qui va se nuancer, s’adoucir ou s’affirmer selon la technique. Je fantasme le classicisme ou le modernise qui va s’imposer à eux sans que je sache pourquoi.
J’observe alors les gestes du maître, ou plutôt je les devine à la position de ses épaules, à la distance qui le sépare de la toile, à la direction de son regard, à la position et au mouvement du coude qui dépasse soudain de la toile. Là, il vient de tracer l’arrondi de l’épaule, le creux des aisselles, la nervure de mon dos. Puis la chute de mes reins, le rebondi de ma fesse.
Maintenant il remonte, tourne, descend en un seul geste pour capter le galbe de ma cuisse, l’arrondi du genou, la parfaite convexité du mollet. Il saisit la sensualité, la sveltesse. Puis je sens qu’il renouvelle le même geste aussi naturellement, aussi volatile, pour caresser du fusain l’autre côté de ma jambe. Caresse fantasmée que je ressens à nouveau sur ma jambe gauche, dessous, dessus ; accostage du ventre, abordage du fessier. Je dois maintenant avoir l’allure d’une Vénus de Milo. Il prend un peu de recul, compare l’œuvre au modèle, retouche légèrement d’une ombre.
Là, ce sont mes bras qu’il exécute. Même célérité dont je ressens la finesse comme si le pantographe de son regard reliait la pointe de son fusain à la fragilité de ma peau. Il semble satisfait.
Maintenant, il fait signe à ma mère qui s’est déjà déshabillée sans que je la remarque, tant j’étais hypnotisée par les gestes du peintre ; tant, consciencieusement immobile je me sentais enfantée par l’impulsion du tracé.
Il place ma mère face à lui, à ma gauche. Il lui demande de se fondre dans mon attitude.
—De profil — Tournez-vous un peu vers moi — un peu plus ; encore ; voilà — remontez les genoux ; accoudez-vous sur eux, la tête entre les mains ; le dos moins rond — Voilà ; un peu plus haut que l’on voit la chute des seins — Écartez légèrement les jambes que l’on devine la toison.
Je perçois chez ma mère moins de séduction, plus d’indifférence dans le regard. Un détachement qui me gagnera sans doute avec l’expérience.
Puis je compose dans ma mémoire les futurs gestes du fusain. Je suis devenu le peintre. Les épaules plus larges, la taille plus épaisse, la cuisse plus ronge, le genou plus cagneux, le mollet plus nerveux. J’observe dans l’esquisse que j’imagine les marques de ma naissance, les indices de la maturité. Soudain je perçois l’indécence de la pause.
Le peintre doit être en train de finir le buste, d’évoquer pourtant avec délicatesse l’encore ronde lourdeur de sa poitrine.
C’est au tour de ma grand-mère de poser. Elle s’assied face à moi, comprend, sans que le peintre n’ait rien à dire, qu’elle doit être mon miroir, calquer ma position puis diriger son regard vers le chevalet.
Alors j’imagine à nouveau que c’est moi qui tiens le fusain. Que je dois juste saisir, à travers trois femmes qui se ressemblent tant, un dos avachi, des reins moins cambrés, une nuque plus raide que martyrisent les cervicales.
C’est à ce moment-là que j’ai été noyée de pudeur. Pas sous les regards du maître et de ses élèves. À cause de trois vies qui s’écoulaient dans la froide nudité d’une esquisse.
Je perçus soudain pour la première fois cette lente érosion qui me guette et la pudeur que je repousserais le jour où prendra place, face à moi, ma petite-fille.
Jean Perguet
Novembre 2023